Depuis la naissance de la force de dissuasion nucléaire française sous l’impulsion du général de Gaulle, la doctrine française s’est bâtie sur un principe inébranlable : l’autonomie stratégique. De Gaulle, refusant de lier le destin militaire de la France à celui des États-Unis comme l’avait fait la Grande-Bretagne, choisit de construire un arsenal souverain, capable d’assurer à la France une capacité de frappe indépendante.
L’explosion de Gerboise bleue en 1960 marque cette entrée fracassante dans le club fermé des puissances nucléaires, suivie du développement d’une triade de dissuasion – composante aérienne, terrestre et sous-marine – qui demeure aujourd’hui le socle de la puissance française.
Cette autonomie n’a jamais signifié un isolement total. Comme le rappelait le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), Bruno Tertrais, dans les colonnes du Monde, « on ne le sait pas toujours, mais la culture nucléaire militaire française a été forgée par des hommes formés dans le cadre de l’OTAN ». La dissuasion française emprunte ainsi des concepts stratégiques américains et britanniques, tout en développant des spécificités propres, comme l’« ultime avertissement », qui envisage une frappe nucléaire limitée sur un objectif militaire avant toute riposte massive. Mais ce qui distingue la doctrine française, c’est son indépendance totale : l’arme nucléaire est exclusivement sous le contrôle du président de la République. Cette indépendance, sanctuarisée depuis les années 1960, est aujourd’hui remise en question par la transformation brutale de l’ordre international.

La souveraineté nucléaire à l’épreuve de l’ordre mondial
Les velléités expansionnistes chinoises puis l’invasion russe de l’Ukraine ont initié une réinitialisation des architectures sécuritaires. L’idéal d’une régulation des conflits par le dialogue et le respect du droit international s’efface devant le pragmatisme des rapports de force, l’équilibre de la terreur nucléaire et la solidité des principes de sécurité collective.
Ce changement entraîne la redéfinition de la notion de souveraineté militaire. La France, vieille nation souveraine, a toujours placé la préservation de son indépendance au centre de ses priorités stratégiques. À l’évidence, l’entretien d’une dissuasion nucléaire autonome et exclusive fait consensus.
Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche accélère un processus entamé sous son premier mandat : le désengagement progressif des États-Unis de l’architecture de sécurité européenne. Cette fois, la rupture est nette. Friedrich Merz, probable chancelier allemand, l’affirme sans détour : « Après Donald Trump, il est clair que cette administration est largement indifférente au sort de l’Europe ». En multipliant les gestes conciliants envers Vladimir Poutine et en fragilisant le soutien occidental à l’Ukraine, Trump pousse l’Europe à se réorganiser en urgence. Dans ce contexte, la dissuasion nucléaire française peut-elle devenir un outil collectif de sécurité pour le continent ? Ou bien doit-elle rester une arme purement nationale, comme l’a toujours voulu Paris ?
L’idée d’un partage de la dissuasion française ne date pas d’hier. Dès 1992, François Mitterrand évoquait la nécessité de ne pas creuser un fossé stratégique entre États dotés et non dotés. En 2020, Emmanuel Macron a relancé le débat en affirmant que « les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne », laissant entendre que Paris pourrait élargir ses engagements en matière de protection nucléaire. Mais jusqu’à présent, ces déclarations n’ont pas été suivies d’effets concrets. Comme le souligne Stéphane Audrand, « personne, encore une fois, en France, dans les cercles institutionnels, ne parle de partager la décision ou le contrôle de l’arsenal nucléaire ». L’indépendance de décision reste un dogme absolu. Pourtant, face à l’effondrement de la protection américaine, l’Europe se retrouve à un tournant historique.
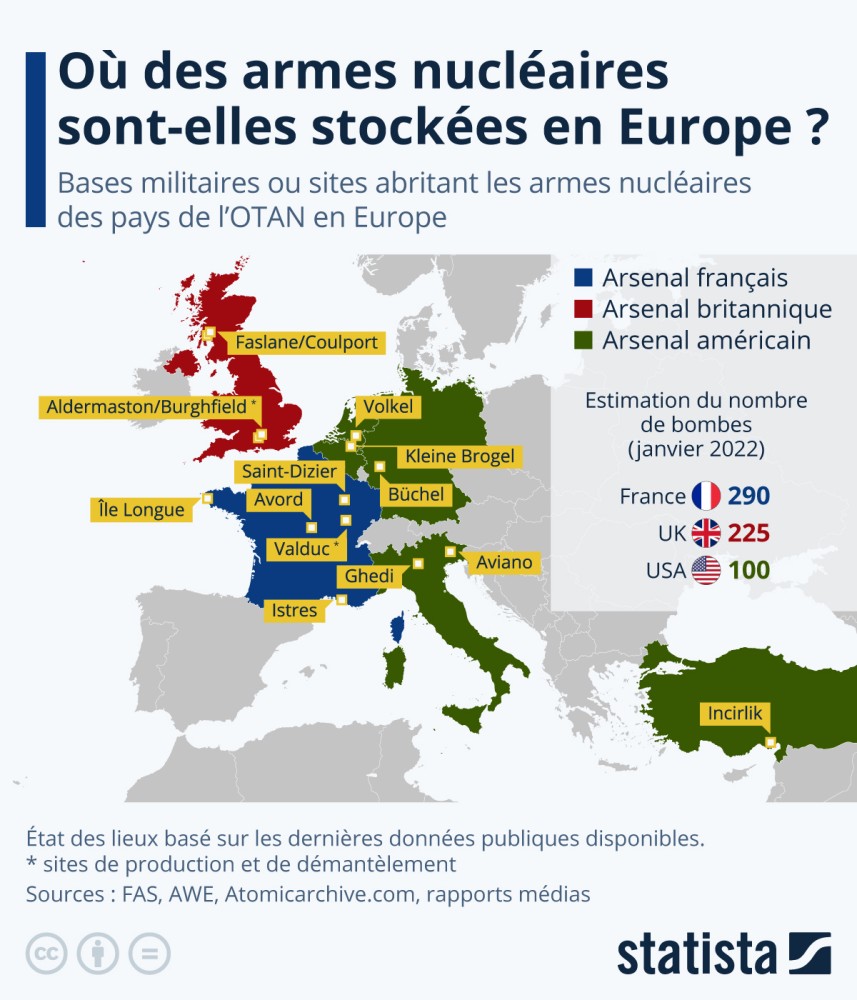
Allemagne, Pologne, France : nouvelles lignes de fracture nucléaires
L’Allemagne et la Pologne sont en première ligne. Depuis 1945, Berlin a construit toute sa défense sur la garantie du parapluie nucléaire américain. Aujourd’hui, cette garantie vacille. Friedrich Merz l’admet : « Nous devons discuter avec les Britanniques et les Français pour savoir si leur protection nucléaire pourrait également s’étendre à nous ». Cette demande est inédite. L’Allemagne, puissance économique majeure, se voit contrainte de repenser entièrement sa posture stratégique.
L’alternative est claire : chercher leur propre solution ou continuer d’être les vassaux d’un allié de plus en plus imprévisible et désengagé. Pour Paris, l’heure du choix approche : l’Europe doit-elle se doter d’un bouclier stratégique indépendant ou accepter le risque d’être à la merci des décisions de Washington ? Si elle décide d’élargir sa doctrine de dissuasion, ce sera une révolution géopolitique. Mais si elle refuse et que l’Amérique s’éloigne définitivement, alors Berlin et Varsovie n’auront d’autre choix que de chercher leur propre solution, quitte à briser l’ordre nucléaire européen.
Ainsi, la France se trouve à un carrefour stratégique majeur. La dissuasion, fondement de sa souveraineté, ne peut plus être pensée uniquement sous l’angle national. L’histoire montre que les rapports de force dictent les nouvelles alliances et les nouvelles doctrines. L’Europe, en quête d’autonomie stratégique, peut-elle réellement se structurer sans intégrer, d’une manière ou d’une autre, la puissance nucléaire française ? La réponse dépendra de la capacité de Paris à imposer une vision claire, à convaincre ses partenaires et à assumer un rôle de leader dans une Europe en pleine recomposition sécuritaire.
Une chose est certaine : une Europe incapable de garantir sa propre défense sera condamnée à la subordination ou à la vulnérabilité.

